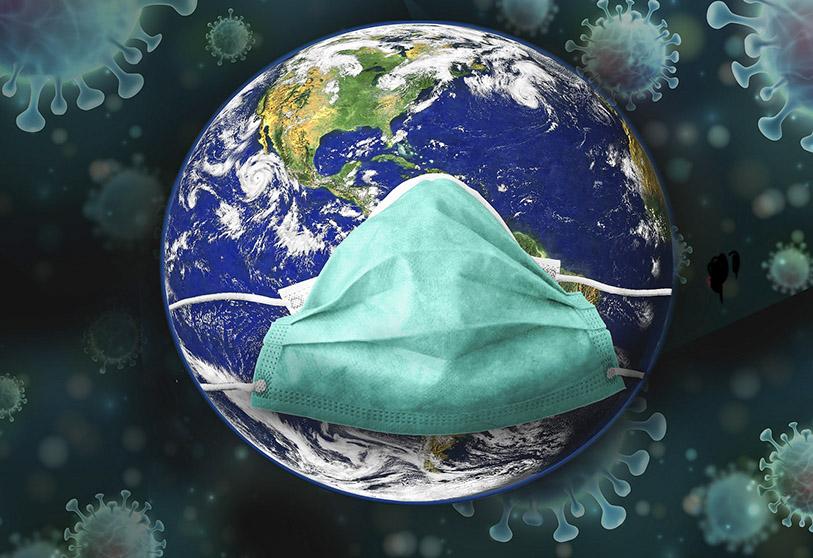II.L’interpellation du Droit international par la pandémie du Covid-19 : un plaidoyer pour une refondation urgente
Le concept de sécurité sanitaire est une notion que l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a intégrée dans la foulée des Accords de Marrakech adoptés en avril 1994. L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), partie intégrante de l’Accord sur l’agriculture relevant de la même institution, prévoit des mesures permettant aux Etats membres de prévenir des risques liés à la propagation de maladies véhiculées par des animaux (zoonoses) ou par des végétaux, à impact sur la santé publique. Il s’agit, en vertu des accords pertinents, de prévenir ce genre de risques, dont ceux liés à la propagation de virus avérés (grippe aviaire, fièvre aphteuse…), d’endémies ou de pandémies (maladie de la vache folle ou encéphalopathie spongiforme bovine), etc.
En la matière, l’OMC renvoie aux accords et aux textes pertinents adoptés par les organisations internationales compétentes, notamment l’Organisation Mondiale de la santé (OMS). L’un des principes majeurs recommandés est celui d’harmonisation qui permet aux Etats de s’aligner sur les standards requis élaborés par les institutions mondiales de référence, dont également la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). C’est ainsi que le Codex Alimnetarius constitue l’un des documents importants relatifs à l’adéquation entre nécessité d’assurer la libre circulation des marchandises et des services avec les impératifs de protection de la santé publique.
Dans le même contexte, le principe de précaution, consacré par les Accords environnementaux multilatéraux (AEM), permet de suspendre des importations de produits contaminés, réellement ou potentiellement, même si les preuves scientifiques avérées y font défaut. A ce propos, il est important de rappeler que Américains et Européens avaient une divergence d’interprétation quant à la portée juridique dudit principe. Si le principe de précaution est consacré par les Accords environnementaux multilatéraux, l’OMC ne lui reconnait pas un statut spécifique. Seul le principe d’harmonisation est reconnu en tant que procédé d’alignement sur les normes et les standards pertinents en matière de protection sanitaire et phytosanitaire.
La crise liée au Covid19 bouleverse la donne du commerce international multilatéral (suspension de certains accords de libre-échange, fermeture des frontières terrestres et maritimes nécessaires au trafic commercial…). A cela s’ajoute les lacunes désormais identifiées, relatives à l’impérieuse nécessité d’aménager une place dans le corpus juridique des organisations internationales pertinentes consacrée aux pandémies transmises ou véhiculées par des humains.
Nous nous trouvons donc, du point de vue du droit international économique en particulier, face à des situations contradictoires qu’il faudra résorber par des réaménagements de fond : comment concilier la libre-circulation des biens, services, capitaux et personnes (accessoirement pour ce dernier cas) avec les risques de propagation de virus, qu’il s’agit de Coronavirus (famille du SRAS : Syndrome respiratoire aigu sévère) ou d’autres pouvant être transmis aussi par des animaux comme Ebola, Influenza… En outre, l’architecture normative de l’OMC (le droit substantiel) devrait subir des changements sous forme d’adaptations, modifications, interprétations… pour tenir compte de la nouvelle réalité épidémiologique mondiale, en liaison bien entendu avec l’activité normative de l’OMS (Règlement sanitaire mondial) et de la FAO prises de façon combinée.
Bœuf aux hormones, encéphalopathie spongiforme bovine (maladie de la vache folle), organismes génétiquement modifiés… Autant de problématiques scientifiques qui soulèvent d’importantes questions, mais aussi des défis considérables au droit pris dans le sens d’instrument de protection, mais aussi d’outil de développement. Le droit ne saurait ignorer les questionnements soulevés aujourd’hui par le problème de l’éthique entendue au sens de morale universelle.
L’OMC a établi un cadre normatif et institutionnel rénové pour la libéralisation des échanges commerciaux mondiaux. L’Accord SPS autorise les Etats membres de l’OMC à se prémunir contre les risques liés à la propagation des maladies, des parasites… véhiculées par des marchandises importées, notamment celles liées au domaine de l’alimentation. La question principale qui se pose est de savoir, quelle est la limite entre la protection légitime en matière sanitaire et phytosanitaire et le protectionnisme commercial, celui-ci étant proscrit, ou du moins stigmatisé par l’OMC. L’Accord SPS a prévu des principes qui visent à instaurer un certain équilibre entre les exigences sus-évoquées (harmonisation, prévention des risques, proportionnalité…).
La pandémie du Covid-19 ne manquera donc pas de pousser profondément vers la révision de tous ces principes et tous ces concepts pour les adapter à la nouvelle réalité mondiale. Il s’agira d’aménager un nouveau cadre normatif et institutionnel mondial qui soit mieux réceptif et mieux réactif aux impératifs sanitaires mondiaux, dont les effets sont globaux.
IV. Une nouvelle fenêtre géopolitique pour le Maroc pour consolider son statut de puissance régionale
Notre pays gagnerait à saisir la fenêtre d’opportunité ouverte par la pandémie du Covid-19 pour consolider son statut de puissance régionale. Depuis sa réintégration au sein de l’Union Africaine (UA) en janvier 2017, le Royaume a prôné une approche collaborative et fédératrice. Le plaidoyer pour un Nouvel ordre sanitaire en Afrique devrait constituer dans les prochaines décennies un cheval de bataille pour le Royaume à l’intérieur de l’UA et au-delà, trouvant dans ce thème majeur un argument de taille pour engager des réformes profondes des systèmes de santé et de veille sanitaire au niveau du continent. Les pandémies devraient désormais occuper la tête de liste de l’Agenda 2063, lequel devrait subir un réaménagement à la lumière de la crise actuelle.
Pour ce qui est de l’implication active du Maroc en Afrique subsaharienne dans la lutte contre la pandémie, notamment la fourniture de vaccins, il est important de souligner que le terrain est en friche. Comme le souligne Hervé Hian, « la survenue de cette maladie crée des opportunités pour accélérer la marche vers le renforcement de la fonction de veille sanitaire, déjà entrepris dans le prolongement des réformes de ces 10 dernières années. La gestion de la COVID-19 dans cette région de l’Afrique a montré l’importance de la mobilisation et de l’implication des communautés dans la gestion de la santé publique et des épidémies, de l’importance du leadership institutionnel dans la riposte et dans la communication sur les risques »[1].
Il est donc nécessaire de consolider la résilience du pays face aux crises potentielles et de développer les moyens de préconisation et de veille stratégique. Il en est ainsi de la nécessité d’investir, plus substantiellement, dans les infrastructures hospitalières, de développer la Recherche/Développement dans les domaines sanitaires, médicaux et autres. Il est également impératif de renforcer l’armature digitale du pays pour garantir la permanence des enseignements à distance et assurer une gestion électronique fluide des dossiers, de s’ancrer plus profondément dans les sciences et les technologies avancées (nanotechnologies, robotique, intelligence artificielle…). Il s’agit en l’espèce d’investissements colossaux, mais dont les effets bénéfiques à long terme sont considérables. Le Maroc pourrait ainsi se positionner par rapport à de nouveaux créneaux et mieux s’intégrer aux chaines de valeur mondiales à l’image des projets déjà opérationnels comme le projet ambitieux PSA monté à Kénitra ou celui de Renault-Nissan à Tanger. Il s’agit maintenant de passer à la phase d’accélération industrielle déjà en branle, conjuguant plans sectoriels aux dynamiques géoéconomiques mondiales
Le Maroc devrait aussi s’investir au plan international pour améliorer la gouvernance sanitaire à l’échelle globale et agir en amont sur les agendas y relatifs, notamment au niveau de l’OMS[2]. Cela appelle à ériger une diplomatie sanitaire appropriée. Or, la structure de gouvernance mondiale héritée de la seconde guerre mondiale est, à l’heure actuelle, complétement inadaptée face aux nouvelles menaces transnationales qui imposent une refondation du système de gouvernance globale, où les acteurs étatiques et non étatiques coopéreront étroitement pour endiguer les nouveaux périls.
En somme, la pandémie de la Covid19 restera ancrée dans les esprits. Elle devrait pousser à la refondation des valeurs de solidarité qui cimentent les membres de la société internationale, tout en préservant les impératifs de sécurité globale. C’est là où s’inscrit le concept de sécurité humaine mis au point par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement). Il s’agit en l’espèce d’un poteau indicateur qui devrait inspirer l’action du Maroc, au niveau national comme à l’échelle internationale. Il est temps d’opérationnaliser ce concept et, par la même occasion, implémenter les Objectifs de Développement Durable promus par les Nations Unies en 2015.
Cependant, l’offensive armée russe en Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, complique la donne d’un système international déjà fragilisé. Les conséquences mondiales de ce conflit armé sont multiples, géopolitiques, énergétiques, alimentaires, financières, psychologiques… Cette crise majeure commande de refonder l’ordre international hérité de la seconde guerre mondiale.
[1] In, « La résilience des systèmes de santé : enjeux de la covid-19 en Afrique subsaharienne », S.F.S.P. | « Santé Publique » 2020/2 Vol. 32 | p. 147.
[2] L’OMS a été critiquée pour sa gestion de la Covid19. Le 29 mai 2020, le président américain, Donald Trump, a décidé le retrait de son pays de cette organisation et la suspension des subventions qui lui sont dédiées.
Related posts
Catégories
- Economie (40)
- Editorial (22)
- Géopolitique (54)
- Histoire (23)
- interview (14)
- Non classé (4)
- Relations internationales (50)
- Strategie (42)
Rencontrer l'éditeur
HANAFI ZAKARIA Docteur en relations internationales, conférencier et expert en géopolitique et sécurité de défense.