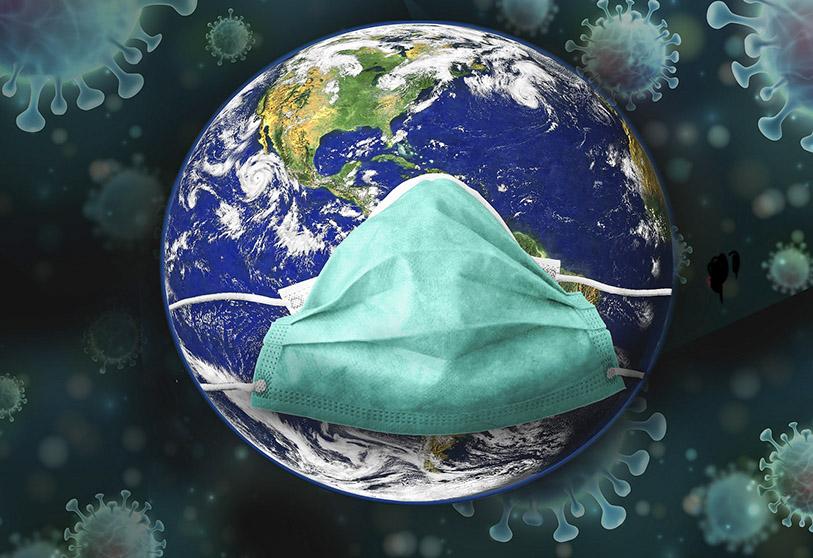L’année 2020 aura été marquée par un bouleversement planétaire sans précédent. La maladie du Coronavirus a frappé fort, n’épargnant aucun pays, aucun secteur et engendrant une nouvelle réalité géopolitique mondiale. Une réalité où, d’abord, le recentrage sur l’Etat comme pivot essentiel des relations internationales et comme « sauveur » a été remarqué et ressenti, et où, en second lieu, les institutions internationales ont montré, dans un premier temps, une incapacité opérationnelle criante à faire face rapidement et promptement à la propagation fulgurante et dévastatrice de la maladie du Coronavirus, partie en premier lieu de Wuhan, en Chine, en décembre 2019, pour regagner en suite le monde entier, dans un contexte d’interconnexion et d’interdépendance entre les pays.
Et ce n’est que le 11 mars 2020, que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré l’épidémie du Coronavirus comme étant une pandémie. Un nouveau contexte géopolitique mondial est né à la suite de cette propagation fulgurante d’un virus mortel, mettant à rude épreuve les dispositifs de santé publique. L’agenda international s’en trouve impacté. Tour à tour, les Etats prennent des mesures pour endiguer le péril, au moment où la gouvernance mondiale a trouvé du mal à fonctionner à plein régime. Cette nouvelle donne devrait pousser le Maroc à repenser son dispositif de lutte contre les menaces exogènes et ses moyens de préconisation, dans un contexte régional et mondial en transformation profonde. Les effets à long terme de la pandémie sont encore à mesurer. Néanmoins, aussi bien la géopolitique que le droit international ont été profondément imprégnés par cette nouvelle donne mondiale. La géopolitique, expression de rapports de force mondiaux, a été plus ou moins « secouée » par la pandémie, propulsant des Etats au-devant de la scène, reléguant d’autres au second plan en fonction des efforts stratégiques fournis pour endiguer le péril. Pendant ce temps, les pays en développement, notamment les moins avancés parmi eux, ont été livrés à eux-mêmes, exposés à des risques amplifiés de contamination de leurs populations, face à la pénurie des médicaments et des infrastructures sanitaires. Pendant ce temps, le droit international, notamment celui de la santé, incarné par l’OMS dans le cadre de ses règlements sanitaires, n’a pas été en mesure de répondre efficacement et promptement à la rapidité de la progression de la pandémie. L’ONU et ses institutions spécialisées n’ont pas vraiment embrayé sur la réalité sanitaire mondiale.
Des enseignements forts sont donc à tirer de cette pandémie mondiale inédite, qui s’est installée partout, révélant au grand jour les vulnérabilités géopolitiques internationales (faiblesse des maillons de solidarité et de réponse adéquate aux crises, y compris au sein de l’Union européenne). Quant au droit international, il aura besoin d’être profondément revitalisé et réaménagé pour intégrer de telles crises majeures dans son corpus juridicum, autorisant plus de malléabilité et d’efficacité, pour répondre de façon efficiente aux crises d’urgence telle la Covid-19.
Le Maroc aura lui aussi fait son exercice de conscience pour tirer les enseignements nécessaires à la suite de la pandémie du Covid-19, non seulement sur le plan de sa résilience aux chocs internes et externes, mais aussi au niveau global, des réformes profondes, structurelles et durables étant à engager, de manière pérenne, pour sécuriser et prémunir le Royaume contre d’éventuelles crises majeures de même ampleur.
Après avoir brossé un bref tableau de la nouvelle donne géopolitique mondiale (1), nous mettrons en exergue le caractère multidimensionnel de la crise engendrée par la Covid19 (II), pour ensuite interpeler la place du droit international face à cette même pandémie (III) et, enfin, interroger le repositionnement marocain dans un contexte de nouvelles opportunités géopolitiques à saisir, notamment sur le plan continental (IV).
I-Une nouvelle donne géopolitique mondiale
Si la géopolitique mondiale pourrait se résumer à une configuration donnée des rapports de force, combinée à des schémas de représentation, il est évident que cette donne a été chamboulée mettant tous les pays, théoriquement du moins, sur un pied d’égalité au niveau de la confrontation au risque majeur lié au Covid19. La meilleure des prospectives n’a pu imaginer, et encore moins anticiper un tel scénario chaotique. L’effet surprise est donc notoire. L’on a remarqué un repli national et l’adoption de postures du self-help prônées par les théoriciens du néo-réalisme, comme l’Américain Kenneth Waltz.
Dans ce contexte d’interdépendance accrue, aux effets domino amplifiés, la mondialisation est plus perçue comme un danger à contenir davantage qu’une opportunité à saisir. La crise engendrée par le Sras-Cov-2 a relégué au second plan les préoccupations géopolitiques habituelles comme celles liées à la nucléarisation de l’Iran ou de la Corée du nord. Paradoxalement aussi, elle a mis de côté des problématiques centrales comme le conflit israélo-palestinien, la situation au Yémen ou en Libye. La crise a par ailleurs fragilisé certains pays, notamment ceux de l’Union européenne (UE) et, à un degré moindre, les Etats-Unis de Donald Trump, et propulsé d’autres comme la Chine dont on a vu combien elle a réagi efficacement à l’endémie alors qu’elle en constituait au début l’épicentre[1].
La Covid19 a révélé les lacunes des mécanismes de coordination à l’échelle globale. Or, face à la rapidité de la dissémination du virus, l’architecture institutionnelle classique s’est révélée impuissante. Ni l’ONU, ni les institutions spécialisées qui lui sont rattachées, n’ont pu venir à bout de ce virus agressif. On a vu aussi comment l’UE, déjà durement impactée par le Brexit, a été prise de court par la pandémie, la reléguant à un rôle marginal face aux replis nationaux en cascade. Chaque Etat de l’UE a tenté, urbi et orbi, d’endiguer le risque majeur, tandis que les dispositifs supranationaux n’ont pas réagi promptement à la pandémie. A ce jour, à fin décembre, un accord final sur le Brexit n’aura pas été trouvée. Sur le plan budgétaire, l’UE a injecté des milliards d’euros dans les circuits pour engager un plan ambitieux de relance économique. Pendant ce temps, et après l’élection de Joe Biden comme nouveau président des Etats-Unis en novembre 2020, les Etats-Unis semblent plonger dans un chaos insurmontable, face à l’augmentation considérable du nombre de nouvelles contaminations et des décès enregistrés.
Dans ce contexte de refondation « épistémologique », lié surtout aux politiques sanitaires, les sciences sociales sont appelées à la rescousse pour repenser la question des pandémies et leurs effets globaux[2]. Un virus planétaire qui a chamboulé la donne géopolitique mondiale[3].
En somme, Michel Korinman nous propose cette configuration géopolitique mondiale qui donne une certaine idée sur le positionnement des puissances internationales et régionales : « Depuis l’élection de Donald Trump en novembre 2016 a été consacré un tripode : la monopuissance (stratégique et financière) américaine, l’hyperpuissance (en premier lieu économique) du géant chinois et la superpuissance (militaire et géographique) de la Russie. Une reconstitution d’alliances est impossible : d’une part à cause de la russophobie de l’État profond aux USA lequel a par tous les moyens (renseignement) fait obstacle au rapprochement avec Moscou (où on en avait rêvé après Septembre2001)6 à l’origine voulu par Trump ; d’autre part en vertu de la nature fondamentalement impériale d’une Russie qui n’acceptera jamais le rôle de junior partner que lui réserveraient les Chinois à l’intérieur d’un bloc commun Et à côté des « trois grands », ce ne sont plus qu’embryons d’empire (Turquie, Iran) lesquels se déploient territorialement en fonction de leurs idéologies et de leurs intérêts »[4].
II-Une crise globale aux effets contrastés
La Covid19 a eu des incidences contrastées sur le Maroc. Déjà sur le plan économique, l’année agricole 2020 semblait mauvaise en raison de la faiblesse de la pluviométrie. Les indicateurs économiques sont en alerte. Beaucoup d’activités ont été durement impactées par la pandémie, comme le secteur de la restauration. Le tourisme a été considérablement affecté et, corrélativement, le transport aérien. Toutes les prévisions budgétaires pour l’année en cours devraient être révisées.
Le commerce extérieur a chuté en raison de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. L’économie mondiale est frappée de ralentissement, ce qui à son tour se retentit sur l’économie marocaine. Pour alléger l’impact socioéconomique de la Covid19, le Maroc, sur initiative royale, a mis sur pied un Fonds spécial dédié au matériel médical nécessaire et aux ménages durement impactés par la crise : secteur informel, commerces de tous genres, travailleurs saisonniers, TPE et PME mises à l’arrêt… De telles mesures ont atténué la précarité de plusieurs personnes exposées à la vulnérabilité ou mises en chômage forcé. On notera aussi la mise sur pied d’un Comité de veille économique pour le suivi de la situation des marchés et celle des ménages. Selon les données disponibles, fournies entre autres par l’Office des Changes, les principaux indicateurs des échanges extérieurs (importations et exportations de biens et services, recettes des Marocains Résidents à l’étranger…) sont négatifs. Un plan de relance économique multi-sectoriel a été préconisé courant mai 2020.
Le Fonds Monétaire International (FMI) prévoit un recul de la croissance économique mondiale de l’ordre de 2,9 pour cent, ce qui ne sera pas sans conséquences sur l’économie marocaine. Dans cette conjoncture spéciale de lock down généralisé, le Royaume a dû faire appel à la Ligne de Précaution et de Liquidité (LPL) autorisée par le FMI. Ce mécanisme permet à des Etats exposés à des chocs exogènes de tirer sur des facilités exceptionnelles. Pour le cas du Maroc, cette LPL avoisinerait les 3 milliards de dollars américains, ce qui ne manquera pas d’alourdir l’encours de la dette extérieure. Des aides spéciales, d’environ 6,6 millions de dirhams, ont été accordées au Maroc par l’Agence américaine pour le développement international (USAID). L’Union européenne, quant à elle, a débloqué la somme de 2 millions de dirhams pour soutenir le Royaume dans ses efforts de lutte contre la pandémie.
En dépit de l’ampleur de la crise et de la surprise stratégique qu’elle a provoquée, le Maroc a fait bonne impression par sa réactivité et la solidarité de toutes ses forces vives. La constitution en un temps record du Fonds dédié à la lutte contre la Covid19 en est un exemple édifiant[5]. En la matière, le leadership royal a insufflé une dynamique vertueuse dans l’ensemble du corps social. Nous avons vu combien le Maroc institutionnel a fonctionné à plein régime, catalysé certes par le danger transversal, mais ayant montré de l’affect envers tous les concitoyens, dont des personnes étrangères bloquées au territoire national. L’état d’urgence a été décrété et un confinement général de la population imposé jusqu’au 20 mai, prolongé au 10 juin. De telles mesures ont évité au Maroc des dégâts plus lourds. Une conjoncture fluide, selon les termes de la sociologie des crises, riche en enseignements et de leçons à tirer, pour édifier un Maroc plus résilient, innovant et ancré dans le savoir. Un Maroc qui puisse aussi mobiliser et tirer profit de ses compétences scientifiques, ô combien nombreuses à l’étranger !
Précisément et en pleine Covid-19, le Maroc a réalisé une percée diplomatique considérable après la reconnaissance de la marocanité entière sur le Sahara, à la suite de la signature d’un décret présidentiel par Donald Trump début décembre 2020. Par la même occasion, l’administration américaine a décidé d’ouvrir un consulat états-unien à la ville marocaine de Dakhla. Cela constitue en soi une réalisation majeure dont les conséquences seront déterminantes. Dans le même sillage, beaucoup de pays, africains et arabes, ont décidé d’ouvrir des consulats à Laayoune ou à Dakhla : Emirats Arabes Unis, Jordanie, Bahreïn, Gabon, l’Union des Comores, la Côte d’Ivoire…La pandémie du Covid-19 n’a donc pas empêché le Maroc de travailler discrètement dans ce sens, profitant de changements d’échelle au niveau de la géopolitique du continent africain, en vue de réaliser de percées diplomatiques.
A SUIVRE…
[1] Pourtant, des critiques, notamment américaines, ont été adressées à la Chine l’accusant d’avoir dissimulé au départ les données autour de la Covid19 et, partant, de n’y avoir pas pris les mesures de prévention nécessaires.
[2] Marc Lazar, Guillaume Plantin, Xavier Ragot (sous la dir. de), Le monde d’aujourd’hui. Les sciences sociales au temps de la Covid, Paris, Presses de Sciences Po, 2020, 386 pages.
[3] « Virus planétaire Géopolitique de la Covid-19 », Outre-Terre, 2019/2 (N° 57), 244 pages.
[4] In « Le pire des mondes », ibid., page 8.
[5] Fin juin 2020, ce Fonds a totalisé environ 35 milliards de dirhams.
Related posts
Catégories
- Economie (40)
- Editorial (22)
- Géopolitique (54)
- Histoire (23)
- interview (14)
- Non classé (4)
- Relations internationales (51)
- Strategie (44)
Rencontrer l'éditeur
HANAFI ZAKARIA Docteur en relations internationales, conférencier et expert en géopolitique et sécurité de défense.